Les fiches récentes
3 mars 2018
Événements : JoRC

Le 2 mars 2018, le Président de la Cour de Justice de l'Union européenne Koen Lenaerts est venu à Paris inaugurer le cycle de conférences organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC), cycle qui a pour titre général : Pour une Europe de la Compliance. S'y associent l'École d'affaires publiques de Sciences po, le Département d'économie de Sciences po, l'École doctorale de droit privé de l'Université Panthéon-Assas (Paris 2) et l'École de droit de l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris I). De nombreuses personnalités y prendront la parole. Ce cycle donnera lieu à l'ouvrage qui sera publié dans la Série Régulations & Compliance sous la direction de Marie-Anne Frison-Roche aux Éditions Dalloz.
Après une conférence admirable offerte par Koen Lenaerts , Antoine Garapon, secrétaire générale de l'Institut des Hautes Études pour la Justice, a parfaitement réagi en "premier discutant", soulignant comme chacun son grand intérêt à l'écoute de la démonstration faite par le Président de la Cour de Justice.
Il a estimé!footnote-95 qu'il n'était guère possible de parler de "Droit de la Compliance"!footnote-91, parce qu'il s'agit avant tout d'un droit qui cesse d'être "prescriptif" pour devenir "relationnel", les entreprises s'organisant pour mettre que des buts soient atteints en relation avec les autorités publiques. Les entreprises développent ainsi un "droit systémique" qui se développe tout seul, avec des mécanismes d'alerte mis en place directement par les entreprises qui se soucient avant de la continuité de leurs activités économiques. La notion de tiers disparaît, une sorte de "gouvernement direct" prend la place du "gouvernement indirect" que représentait le "tiers de justice", les entreprises ayant intégré ce tiers dans leur propre organisation, ce qui bouleverse leur rapport au temps et met en place un système "métajuridique".
Antoine Garapon pose alors la question de savoir comment une telle "conversion" a pu s'opérer, c'est-à-dire ce passage du mode de contrôle de l'Ex Post à l'Ex Ante, aboutissant à ce que les entreprises internalisent la tâche d'effectivité des règles !footnote-92. Il estime qu'il faut d'une part que le système qui le prône est la "puissance de marché pour l'imposer et que d'autre part ceux qui au sein de ce système le demandent explicitent une "vision du monde". Antoine Garapon ajoute la nécessité d'une "ambition morale".
Or, Antoine Garapon a souligné les États-Unis ont réuni ces trois conditions.
Dans sa discussion, Antoine Garapon a en revanche estimé sur le fait que l'Europe ne les a pas réunies et qu'elle "part avec un handicap", parce qu'elle n'est pas tournée vers l'extérieur, parce qu'elle n'a pas de vision du monde, parce qu'elle n'a pas opéré d'intégration morale.
Il a insisté sur le fait que la Cour de Justice peut porter ces trois conditions, notamment à propos des données personnelles. Car c'est bien à propos du numérique que l'Europe a un pouvoir de marché. C'est bien à propos des donnés personnelles que la Cour de Justice est le lieu où l'Europe est à la fois un marché et des valeurs!footnote-93.
C'est pourquoi la Cour de Justice de l'Union européenne a effectivement un rôle central pour cette construction.
______
Ces propos très construits, très instructifs d'Antoine Garapon!footnote-94 , merci à lui, ont parfaitement montré, en miroir de la conférence du Président de la Cour de Justice, l'enjeu : l'avenir.
Au-delà des disputatio autour des définitions, c'est effectivement la question de savoir si l'Europe va ou non construire des mécanismes propres de Compliance.
En trouvant un vocabulaire qui lui sont propres. Non seulement en langue française, car le Droit est fait des mots, mais encore avec des mots nouveaux, qui nous sortent du "traduit-collé" et qui porteront des ambitions européennes, comme le fût le cas pour le "droit à l'oubli", très souvent cité dans la discussion.
Certes il faut le "pouvoir". Mais il faut déjà le prétendre. Et le Droit a toujours prétendu exister. C'est en cela qu'il est un Ordre. C'est sans doute pour cela que le président Koen Lenaerts a insisté sur la "juridicisation" de la compliance, comme le fait la main du Droit qui se pose sur un objet.
3 mars 2018
Événements : JoRC

Lors de la discussion qui a suivi la conférence inaugurale du Cycle Pour une Europe de la Compliance que Koen Lenaerts a consacrée au Rôle de la Cour de Justice de l'Union européenne dans la construction de l'Europe de la Compliance, et après une première discussion menée par Antoine Garapon, une problématique est plus particulièrement apparue.
En effet, le président Ken Lenaerts a repris la question de l'influence de l'adoption d'un "programme de conformité" par une entreprise lorsque par la suite un comportement anticoncurrentiel est imputé à celle-ci.
Les autorités de concurrence ou de régulation, ainsi que les juridictions, ont trois possibilités : soit considérer que l'entreprise avait fait ce qu'elle pouvait pour prévenir ce comportement, éduquer les personnes dont elle a la charge, que cette prévention n'avait pas suffi mais qu'il faut en tenir compte à sa "décharge" pour alléger sa sanction ; soit considérer au contraire que l'adoption d'un tel programme de conformité par l'entreprise par lequel elle exprime sa volonté expresse et pro-active de porter elle-même l'efficacité de la norme tandis que dans le même temps elle la méconnait constitue une circonstance aggravante de sa responsabilité ; soit considérer que le fait doit demeurer neutre dans l'appréciation que le juge fait du comportement.
La Cour de justice s'en tient à la troisième solution.
Mais chacun reconnaît qu'il s'agit d'une question essentielle et pour laquelle les arguments sont fondés, la Commission européenne penchant quant à elle pour la qualification d'un fait aggravant.
Lors de la discussion, il a été souligné en sens inverse que dans la perspective de la Compliance comme mécanisme incitatif, ne pas prendre en compte de la part des entreprises l'adoption de programmes si coûteux est très décourageant pour elles. En outre, cela contredit la définition de la Compliance comme "pacte de confiance" entre l'entreprise et l'autorité publique.
____
Que peut-on notamment retirer cette discussion d'un très grand intérêt ?
Qu'il s'agit donc une question qui demeure ouverte, parce que les arguments sont solides et que l'on pourrait dire que "chacun a raison", et les entreprises qui veulent que l'on prenne acte de leur comportement, et les autorités qui ne peuvent pas qu'on les abuse par ce qui ne serait qu'un paravent de comportements violant le Droit.
La question est sans doute de savoir si le choix de "neutralité" de la Cour de Justice est une solution d'attente ou une décision de non-choix, parce qu'on ne pourrait jamais savoir si une entreprise est "sincère" ou non lorsqu'elle adopte un programme de Compliance.
C'est sans doute ici qu'une solution pourrait être trouvée : dans des mécanismes probatoires. Car dans ces matières-là, c'est par des procédés techniques par lesquelles le sujet de droit (c'est-à-dire l'entreprise) donne à voir qu'elle a tout fait pour atteindre son but (obligation de moyens renforcée).
C'est sans doute en formulant des exigences probatoires de ce type que la Cour de justice pourrait sortir de sa position de neutralité. Car s'il est vrai que le juge doit être "impartial" par rapport aux faits, l'attitude qui consiste à donner aucune "pertinence" à un fait aussi important que les programmes de compliance est en soi contrariant. Il semble difficile d'y associer une règle de fond, pas plus qu'il n'est souhaitable de faire de la casuistique. Mais, et le droit économique s'y prête, un système probatoire que la Cour énoncerait clairement serait peut-être une bonne solution.
____
Dans l'ouvrage qui paraîtra à la fin du cycle de conférences, un article sera inséré dans l'ouvrage sur cette question plus particulière de la portée des programmes de conformité sur l'appréciation du comportement de l'opérateur au regard des faits qui lui sont reprochés, question sur laquelle les différents régulateurs des différents systèmes juridiques divergent.
22 février 2018
Thesaurus : Soft Law
4 février 2018
Translated Summaries : Isolated Articles

La Régulation passe par du vocabulaire, des mots, et l'Union européenne a pour langues officielles le Français et l'Anglais. Mais la pratique conduit à rédiger les documents dit "préparatoires", comme les rapports dans la seule langue anglaise, seuls les communiqués de presse étant encore traduits. Dans la mesure où ces rapports sont le creuset de la conception même des systèmes, l'usage du seul anglais conduit au développement d'une pensée britannique et de la Common Law, puisque c'est bien d'une transformation du Droit de la Régulation qu'il s'agit.
Ainsi en est-il du rapport publié le 31 janvier 2018 par la Commission européenne, issu des travaux du "groupe de haut-niveau" formulant des propositions pour une "finance soutenable", ou pour l'exprimer selon le document d'origine, puisqu''ici parler en langue française c'est déjà traduire :
Ainsi, ce rapport dont les conclusions reprennent les celles du rapport
3 février 2018
Sur le vif

La Compliance consiste à internaliser l'Ex Post dans les entreprises pour que celles-ci se structurent afin de prévenir des phénomènes systémiques néfastes. Elle le fait plus ou moins nettement, plus ou moins fortement. Au Royaume-Uni, comme en matière de Régulation, elle le fait nettement et clairement.
Par exemple à propos de la sécurité numérique.
La sécurité numérique est un jeu majeur pour toutes les entreprises, les États et les personnes privées.
A première vue, sa garantie repose sur les États, garants de la sécurité des personnes, la "sécurité numérique" (par exemple la protection des personnes contre la cybercriminalité, comme le vol des données) n'étant qu'une modalité nouvelle de cette fonction première des États.
Mais l'effectivité de cette sécurité numérique repose avant tout sur les entreprises et cela pour trois raisons.
Tout d'abord parc c'est d'elles que naissent les risques, que c'est par elles qu'ils se propagent. Elles ont donc comme un "devoir" de lutter contre ce qu'elles ont elles-mêmes fait naître.
Ensuite parce que les comportements qui compromettent la sécurité numérique dépassent techniquement et politiquement les États, enfermés par nature dans des frontières alors que les comportements visés sont globaux. Ce face à quoi les entreprises sont moins démunies, puisqu'elles sont elles-mêmes globales.
Enfin, parce que les investissements en argent, en temps et en personnes (ces deux dernières dimensions pouvant se réduire à la première) sont si importants qu'il est en pratique plus pertinent pour les États de donner ordre aux entreprises de faire ces investissements structurels (mise en place de technologie, surveillance du fonctionnement efficient de celles-ci) plutôt que de le faire eux-mêmes.
Toutes les conditions de la Compliance sont remplies.
Le Droit de la Compliance n'a donc plus qu'une chose à faire : prévoit une très forte amende si les entreprises ne s'exécutent pas, en prenant en charge elles-mêmes la sécurité numérique des personnes.
Mais il ne peut s'agir de toutes les entreprises. Il est essentiel que le Droit de la Compliance ne s'applique pas aveuglement à toutes les entreprises. Il ne doit s'agir que des entreprises "en position" de remplir la fonction qui leur a été assignée pour "atteindre le but" qui a été politiquement posé.
Par un communiqué du 28 janvier 2018 venant de plusieurs ministères, le Royaume-Uni a donc fait connaître de viser les entreprises qui,, en tant qu'elles sont des "critical industries" sont objectivement aptes à garantir cette sécurité numérique, à savoir les entreprises des infrastructures numérique, mais également les entreprises du secteur de la santé, de l'énergie ou du transport, c'est-à-dire les entreprises régulées (les entreprises des secteurs financiers, bancaires et assurantiels étant déjà contraints par des règles spécifiques). Cette liste des "entreprises éligibles à la Compliance" conforte le fait que le Droit de la Compliance est l'aboutissement du Droit de la Régulation.
Présentant cela comme une décision de contrainte sur les entreprise prise pour le bien de ces entreprises, il est prévu que si celles-ci ne mettent pas en place ces dispositifs, elles pourront être sanctionnées par une amende pouvant aller jusqu'à 17 millions de livres.
Dans ces conditions, les entreprises sont effectivement incitées à suivre les lignes directrices instaurées et publiées le même jour par le National Cyber Security Centre ....
Le dispositif de l'Union européenne, par la directive européenne du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans l'Union, comptait sur des bonnes pratiques qu'il convenait de suivre et d'encourager par de multiples incitations.
La France transpose avec un système qui s'appuie un organisme qui est une "agence" et non pas un "régulateur" , l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information , le droit français instaure des procédures entre les "opérateurs de services essentiels et celle-ci (dans une relation de type pédagogique), mais prévoit relativement peu de sanctions, celles-ci étant peu lourdes.
Au Royaume-Uni, qui n'est plus désormais visé par une hiérarchie des normes la rattachant à l'Union,adopte plutôt un système avant tout d'amendes et prend comme chemin principal la voie répressive. Comme tout pays adossé à un système libéral, c'est sur de la répression que le système se base.
Le choix fait par le Royaume-Uni montre une nouvelle fois que le Droit de la Compliance est un droit répressif structurel.
18 janvier 2018
Événements : JoRC
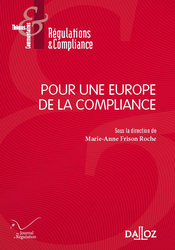
Le précédent cycle de conférences a porté sur Régulation, Supervision, Compliance, et débouche sur un ouvrage, publié en 2017 dans la Série Régulations des Éditions Dalloz. Dans cet ouvrage, il s’agissait dans une approche notionnelle de montrer comment la Compliance, mécanisme venu des États-Unis, consiste à internaliser dans certaines entreprises des obligations mises à la charge de celles-ci.
En 2018, le cycle de conférences débouchera également sur un ouvrage. Il adopte une approche plus dynamique : il s’agit de construire l’Europe de la Compliance. Les conférences composant le cycle ont pour objet commun de réfléchir à la façon dont l’Europe non seulement reçoit ce corpus américain mais encore reconstruit un tel dispositif. Conférences et débats vont permettre de l’étudier pour l’avenir, non seulement dans les différents pays qui composent l’Europe mais encore dans le projet européen lui-même.
Il s’agit donc d’un sujet scientifique et technique, mais aussi d’un projet politique, intégré dans la perspective de la construction européenne, non seulement économique (dans son articulation avec l’Union bancaire et l’Union des marchés de capitaux) mais encore, voire surtout, intégrant des buts qui dépassent cette circulation et convergence d’intérêts pour se soucier de buts comme la préservation de l’environnement ou le souci des personnes. C’est une affaire d’État. En cela, le Droit de la Compliance, tel que développé par les États-Unis est certes un modèle mais peut être dépassé par une ambition plus haute, que l’Europe peut porter et qui peut porter l’Europe.
L’étude de ce thème Pour une Europe de la Compliance prend tout d’abord la forme d’un cycle de conférences qui se déroule en 8 sessions. Chaque session dure 2 heures, dans un débat public entre une personnalité qui participe à la construction d’une telle « Europe de la Compliance », un modérateur (qui est un professeur), un « premier discutant » (qui vient plutôt d’un autre pays européen que la France), l’auditoire participant activement à ce débat.
Parallèlement, les contributions à un ouvrage sont élaborées en s’appuyant sur les contributions à ces manifestations publiques et en les complétant. L’ouvrage sera publié dans la série Régulations aux Éditions Dalloz (dans laquelle sont déjà parus des ouvrages sur la Compliance).
Le cycle s'appuie sur des sessions mensuelles, situées en fin de journée (entre 18h et 20h).
Il est organisé sous la direction scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, professeur de droit économique à Sciences Po, directeur du Journal of Regulation and Compliance (JoRC) . Il est organisé par le Journal of Regulation and Compliance (JoRC) avec l’École d’Affaires Publiques de Sciences po (Paris), le Département d’Économie de Sciences po , l’École de Droit de l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), l’École doctorale de Droit privé de l'Université Panthéon-Assas (Paris II) et les Éditions Dalloz.
Consulter la liste actualisée des intervenants.
Consulter les informations relatives aux conférences de mars, avril, mai, septembre, octobre et décembre 2018.
Consulter une présentation globale de l'ensemble des conférences.
Lire les conditions d'inscription, et les conditions d'accès à chaque session (attention, les sessions se déroulent dans des lieux différents, soit à Sciences-Po, soit à Paris I, soit à Paris II).
Lire l'ensemble des comptes-rendus des conférences du cycle " Pour une Europe de la Compliance " :
20 décembre 2017
Parutions : I. Articles Isolés
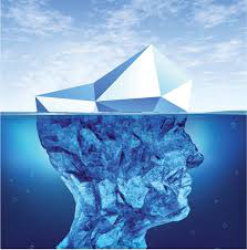
Les opérateurs cherchent à n'être pas tenus par les règles de Droit. Pour cela, ils utilisent le plus efficace des moyens : le Droit lui-même.
Ainsi, Uber dont chacun sait qu'il fait fortune en permettant à des usagers de monter dans des voitures pour aller d'un point à un autre explique qu'il est une entreprise de "plateforme", constitutive d'un "marché biface", qu'il n'a jamais vu une voiture, qu'il ne connait aucun chauffeur et qu'il se meut dans ce monde nouveau qu'est le monde numérique.
Cette façon, si habile, qui consiste à prendre les auteurs de la règle et ceux qui l'interprètent pour plus niais encore qu'ils ne sont, est maniée devant si longtemps. Elle consiste à utiliser le Droit dans sa puissance formelle à prendre distance par rapport à la réalité factuelle, et de se prévaloir ensuite de cette distance-là, de la puissance juridique pure pour n'être en rien tenu par le réel.
Le Droit tient effectivement son existence même dans sa distance entre le réel. Le meilleur exemple est celui de la "personne morale", sujet de droit titulaire de prérogatives juridiques et d'obligations, existant par la seule volonté et la prévision qu'en a eu le système juridique.
Mais le Droit de la Régulation est par nature d'une part un Droit qui part des choses, un droit concret, un "Droit des choses concrètes" (un droit du téléphone, un droit du chemin de fer, de l'électricité, etc.), qui reconcrétise un mot que le Droit de la concurrence avait contribué a neutralisé puisque tous les objets s'échangeant, leurs substances devenait indifférentes, le numérique accroissant l'indifférence de la substance comme le montre ces plateformes que le Droit a tant de mal à saisir.
Ainsi, à travers UBER, le Droit de la Régulation voit simplement un service de transport.
De la même façon, à travers une personne morale, le Droit de la Régulation voit simplement les personnes qui sont derrière la structure juridique et qui en bénéfice.
Or, et d'autre part , le Droit de la Régulation est par nature est un droit qui est fait pour contrôler les pouvoirs.
En cela, les techniques juridiques peuvent être utilisées par les opérateurs autant qu'elles le veulent, parce que la Régulation est une technique qui s'insère dans un système libéral, aussi bien politiquement qu'économiquement, mais elles ne peuvent pas être utilisées pour permettre à des opérateurs pour se soustraire au contrôle du Régulateur.
C'est pourquoi lorsqu'un cas est soumis au Régulateur, comme cela fût le cas pour UBER, le Régulateur des transports de la ville de Londres a le 22 septembre 2017 appliqué à cette entreprise la totalité des exigences associées à l'activité de transport, estimant que les manquements reprochés aux chauffeurs lui étaient imputables, UBER ne pouvant pas couper le lien d'imputation sous prétexte qu'elle ne relevait que du numérique, lien d'imputation qui justifia le non-renouvellement de la licence.
De la même façon, la Cour de Justice de l'Union Européenne, par son arrêt du 20 décembre 2017, vient de procéder au même exigence de qualification, qui est des simples : UBER a une activité de transport, ce qui justifie les exigences et les contrôles attachées à cette activité, à la fois essentielle économiquement et socialement et dangereuse pour les personnes transportées.
Il ne s'agit pas même d'une "démonstration", mais d'une "monstration" : le Droit de la Régulation, parce qu'il est concret et veut effectivement contrôler, "regarde" la réalité des choses, et ce que chacun voit, il veut le voir aussi.
Ce qui arrive dans la Régulation des transports, et ce que ne peut masquer la paradoxale opacité de l'immatérialité du numérique, on la retrouve dans le Droit des sociétés que la Régulation bancaire et financière est en train de transformer.
En effet, La loi du 9 décembre 2016, dite "Sapin II" contribue à mettre fin à l'idée même de personne morale en tant qu'elle recouvra d'une voile d'opacité des personnes intéressées à la constitution d'une personne morale. En instituant un "Registre des bénéficiaires effectifs" des sociétés qui seront créées (en dehors des sociétés cotées), l'idée est de savoir qui contrôle la société, laquelle n'est plus définie comme une "personne" mais comme un "instrument".
Ce registre qui a donc pour objet de montrer qui a le pouvoir de décider dans l'instrument sociétaire et qui est le véritable "bénéficiaire" de sa création, est établi pour le bénéfice des autorités de contrôle, notamment celles qui luttent contre le blanchiment d'argent, mais aussi toute partie prenante autorisée par un juge.
Cette modification du Droit achève la dilution du Droit des sociétés dans le Droit de la Régulation relève du même mouvement : le Droit est l'instrument de révélation de la réalité des puissances d'une part et le moyen de les contrôler d'autre part, sans pour autant que soit remis en cause le principe du libéralisme.
27 novembre 2017
Sur le vif

Les systèmes de Régulation tiennent à tenir de plus en plus sur des prérogatives des personnes, des "droits subjectifs", que l'on considère cela comme un mouvement de "civilisation" des systèmes économiques naguère tenus par les États ou que l'on y voit une technique d'efficacité à travers des incitations adressées à des entités rationnelles, appelées à agir pour que l'intérêt collectif soit respecté.
Sans doute un peu des deux.
Mais dès l'instant qu'il y a des "droits subjectifs", certains peuvent être consubstantiels à la personne, c'est-à-dire relever non seulement du Droit de la Régulation mais encore des Droits humains.
Et de la même façon que les juridictions appliquent souvent des Droits humains de nature processuels (par exemple les droits de la défense), pour poser des limites au Droit de la Régulation, souvent gouverné par le principe méthodologique de "l'efficacité" parce qu'il est un droit téléologique, il arrive que les droits humains soient eux-même issus des systèmes de régulation.
C'est ce que met en lumière l'arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de l'homme, dans son arrêt du 19 octobre 2017, Fuchsmann c/. Allemagne.
Dans le cas examiné, s'opposaient deux droits fondamentaux.
Le premier, le "droit à l'information", est certes classique dans les droits humains mais prend un nouveau relief dans les systèmes de régulation, car l'information est le principe majeur de fonctionnement du système lui-même, par exemple en finance ou en banque, au-delà du principe démocratique, l'espace numérique étant à la croisée des deux perspectives.
Le second, le "droit à l'oubli" est né des systèmes de régulation. Il cristallise un droit au contrôle des fiches et, depuis l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne Google Spain, une incitation faite aux personnes d'exercer un contrôle sur les entreprises maîtresses du numérique. C'est alors le Droit, plus ancien, des droits humains, qui a recueilli, cette prérogative toute nouvelle "à l'oubli", jusqu'à éventuellement redessiner la prescription sur ses contours.
Mais ces deux droits subjectifs s'opposent. Et ce sont aussi bien les Régulateurs, les juridictions économiques que les juridictions des droits humains qui vont opérer l'équilibre. Et c'est ce que fait l'arrêt du 19 octobre 2017.
En effet, le New-York Times avait publié un article à propos d'une personne. Et comme désormais les journaux conservent leurs articles en complète disponibilité online , il demeure pour les internautes possible de trouver aujourd'hui encore cet article dans lequel il est décrit que cette personne, nommément visée, a des liens avec le crime organisé. Celle-ci s'appuie sur le droit de la Régulation numérique, revendique donc son "droit à l'oubli" pour obliger le journal à rendre indisponible cet article (l'article n'étant pas séparable du nom de celui sur lequel l'article porte), donnée que la personnalité entend recouvrir du manteau protecteur de "l'oubli".
L'éternité de l'archivage électronique vient-il changer les solutions ?
Non.
Dans cet arrêt Fuchsmann c/. Allemagne, la CEDH pose que le "droit à l'oubli" s'efface lorsque le journal a parfaitement respecté les droits de la personne en question avant la publication ("duty of care" d'une part et que l'intérêt général du public à être informé est en cause : "the informational interest of the public outweighed the concerns of protecting the applicant's personality right, even taking into account that such reporting might seriously damage his private and professional reputation.".
Les critères sont classiques dans la jurisprudence de la CEDH.
Cela signifie aussi que le "droit à l'oubli" n'excède pas ce pourquoi il a été conçu : le retrait d'une "donnée " très particulière : un nom dans un fichier. Un article n'est pas un fichier. Le "droit à l'oubli" n'entame pas la prescription mais plus qu'il ne saurait détruire le droit à l'information, qui se transforme par la force du Droit de la régulation en principe de "transparence".
Devant la Cour européenne des Droits de l'Homme, le Gouvernement allemand avait en défense refusé expressément de concevoir le "droit à l'oubli" (sur le terrain des droits humain) comme l'a conçu la Cour de justice de l'Union européenne (sur le terrain de la régulation numérique), position résumé dans l'arrêt en ces termes :
L'arrêt de la CEDH ne reprend pas cette allégation. Mais il ne reprend pas non plus l'expression de "droit à l'oubli".
Pourtant, il prend position sur la question de l'archivage online des articles de presses nominatifs, qui auraient pu justifier une application par analogie du droit à l'oubli.
Et sa position est de principe, penchant du côté de l'intérêt général à l'information, en ces ces termes :
"Moreover, given the great public interest in the corrupion allegations, there was also a public interest in mentioning the applicant by name. The Court agrees with the conclusion of the Court of Appeal that the article contributed to a debate of public interest and that there was public interest in the alleged involvement of the applicant and mentioning him by name. The Court of Appeal further held that public interest also existed in the publication of the article in the online archive of the newspaper. It reasoned that the public had not only an interest in news about current events, but also in the possibility of researching important past events. The Court agrees with this conclusion, too. It notes the substantial contribution made by Internet archives to preserving and making available news and information. Such archives constitute an important source for information".
Ainsi, l'arrêt dans sa réponse et son expression prouve montre que si les systèmes de régulation ont tendance à dévorer les autres systèmes et branches du droit, ci en généralisant un "droit à l'oubli", qui n'avait été conçu que pour gérer la question des fichiers informatiques, ce droit subjectif réimplanté dans le droit classique retrouve sa place raisonnable, ici l'information, équilibre qui est lui-même la marque du Droit de la régulation lui-même et qui rappelle que le maître du système est à la fin toujours le même : le juge.
