Les fiches récentes
24 novembre 2017
Sur le vif

Ce sont les cas, et donc les jugements qui tranchent les disputes à leur propos, qui finissent par révéler des évolutions déjà opérées mais encore masquées, ou qui les achèvent, ou qui les constituent d'un trait.
Ainsi en est-il de donner la qualification des "titres" qui constituent les "biens financiers", à propos desquels Michel Jeantin écrivit un article précurseur, exercice de qualification qui occupe aujourd'hui des thèses de doctorant.
Mais enfin, le Droit financier trouvant encore un peu sa source dans le Droit des sociétés, enfin le croyait-on, on en restait à la distinction fondamentale entre l'action et l'obligation, même si les techniques financières ploient aujourd'hui l'un vers l'autre, de sorte que les choix des investisseurs entre les "marchés-actions" et les "marchés-obligations" ne tiennent pas guère à leur distinction juridique.
Toujours est-il que si les mots ont encore un sens, et le Droit n'est fait que de mots, l'action demeure un "titre de capital" ce qui conduit son titulaire à courir (un peu) du risque de l'entreprise et n'être remboursé qu'en dernier (en boni de liquidation) tandis que l'obligation est un titre d'emprunt. C'est pourquoi en Droit des sociétés l'augmentation de capital et l'emprunt obligataire sont des techniques si différentes.
Mais ça, c'était avant.
Avant que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ne rende le 23 novembre 2017 l'arrêt Generali Vie.
_____
Dans cette affaire, que le site de la Cour de cassation classe sous le simple visa de "Assurances (règles générales)", on voit se dérouler le drame suivant. Un particulier souscrit un contrat d'assurance-vie en unités de compte. Avant le terme de son contrat, il place l'ensemble de sa prime sur un autre produit, unique support, que l'assureur a dénommé commercialement "Optimiz Presto". Celui-ci n'est pas garanti en capital à échéance. Or, le "produit" a de mauvaises "performances" et à l'échéance, le client ne retrouve pas son capital.
Mais il se souvient alors de la façon dont l'assureur lui avait présenté les choses, à savoir comme un "produit obligataire non garanti en capital à échéance et dont les actifs concernés sont admis sur le marché officiel de la Bourse de Luxembourg". Le client, devenu plus juriste que Monsieur Jourdain, affirme que lorsqu'on lui dit "produit obligataire", on lui dit "remboursement à l'échéance du capital". Parce que c'est ce que le mot "Obligation" veut dire". Certes, ensuite il y a mention du fait qu'il n'y a pas de garantie du capital, mais en termes galants l'on dirait qu'il y a oxymore, en termes courant l'on dirait qu'il y a charabia, et en termes juridiques l'on dirait qu'il y a défaut d'information car l'assureur aurait dit lui dire que là où il y avait marqué "produit obligataire" il fallait comprendre tout sauf... "obligation".
Les juges du fond ont suivi ce raisonnement fondé sur la qualification et condamné l'assureur pour manquement à l'obligation d'information et parce qu'un "produit obligatoire" donnant par définition lieu à rembourser à l'échéance il n'était pas "éligible" à la description faite pour le produit "Optimiz Presto".
Et voilà que la Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel. Non pas sur l'obligation d'information, mais sur ce qu'est un titre obligataire. Dans l'arrêt Generali Vie du 23 novembre 2017, elle ne dit ce que c'est mais elle dit ce qu'il peut ne pas être. Et c'est déjà une révolution : le Droit financier n'a définitivement plus besoin du Droit des sociétés.
_____
En effet, la Cour de cassation se fonde non pas sur le seul Code des assurances mais sur le Code monétaire et financier avec lequel le premier doit s'articuler.
Elle pose donc dans un attendu présenté formellement comme un attendu de principe que "les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale".
Dès lors, elle relève une différence entre cette définition (très large et commune à de nombreuses titres) avec celle - si classique - que les juges du fond ont quant à eux affirmé que "l'obligation est ... un titre de créance représentatif d’un emprunt et dont le détenteur, outre la perception d’un intérêt, a droit au remboursement du nominal à l’échéance ".
Partant, la Cour de cassation ne peut que casser, puisque selon elle les juges du fond en posant que "la qualification d’obligation n’est pas subordonnée à la garantie de remboursement du nominal du titre".
____
Le Droit financier a donc dévoré le Droit des sociétés.
Les juges du fond savent lire et ce n'est pas dans les diverses réglementations qu'ils avaient trouvé cette définition, mais dans une sorte de nature des choses, affirmant que le remboursement du capital est une "obligation essentielle" du régime du titre qui justifie qu'il reçoive la qualification d'"obligation".
La Cour de cassation ne les suit pas. Elle relève simplement la mention du prospectus agrée par le Régulateur du marché du Luxembourg, indiquant que l'absence de remboursement du capital au terme d'une obligation est un "inconvénient".
Les financiers peuvent donc écrire n'importe quoi.
ie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
12 septembre 2017
Parutions : I. Articles Isolés
La qualification est l'opération clé en Droit.
Par exemple, si l'on "dit" ce qu'est un bitcoin, alors on lui affecte le régime qui correspond à la "nature" que l'on a ainsi dite;
L'on pourrait dire que le "jeton" qu'il constitue ne correspond à rien de ce qu'il existait avant. Dans ce cas, leur création, leur stockage, leur gestion, leur vente, leur prêt, leur achat, ne correspond à aucune catégorie particulière qui leur préexistait. Ils relèvent donc de ce que l'on appelle "l'innomé".
C'est alors dans un système libéral le vide de la liberté qui s'applique à lui. Dans un système de liberté, c'est la liberté contractuelle, c'est la liberté qui s'attache au droit de propriété, l'articulation entre le contrat et la propriété suffisant. La technologie peut asseoir une telle qualification, parce que le risque inhérent à un système de liberté est par ailleurs pris en charge par le mécanisme des blockchains. En effet, par la diffusion du risque d'une part, par la sécurité des machines d'autre part, il n'y aurait pas de souci à se faire, et le principe de liberté pourrait accréditer l'idée que le "jeton" serait une catégorie sui generis.
Mais banques centrales et régulateurs financiers ne sont sans doute pas convaincus et préfèrent opérer une qualification en rapportant le "jeton" à une catégorie préexistante, ce qui déclenche automatiquement le régime juridique. On sait bien que l'art de la qualification consiste à choisir parmi les qualifications atteignable celle qui permettra l'application du régime qui est le plus adéquat pour satisfaire le but que l'on veut atteindre. En matière de Régulation, gouvernée entièrement par les buts, la qualification est donc avant tout une affaire de stratégie.
Or, affirmer que le bitcoin est un objet sui generis revient à ne pas en réguler l'émission, les usages et les intermédiations, à ne pas en contrôler non plus ceux qui en font profession. Revient à ôter sur les mérites de l'autorégulation.
Cela a été exclu.
Tout d'abord par les Banques centrales. En effet, l'on peut qualifier des bitcoins et autres jetons, appuyés sur la sécurité mécanique du blockchain, de "monnaie" lorsqu'il s'agit par leur acquisition de permettre d'acheter d'autres biens. Les banquiers centrales ont retenu la qualification de "monnaie", ce qui n'interdit pas leur émission mais ce qui justifie l'application de la régulation bancaire.
Ensuite par les Régulateurs financiers. En effet, l'on peut qualifier ces mêmes jetons de titres et instruments financiers lorsqu'ils sont émis par des personnes qui les émettent pour lever des fonds, les acquéreurs apportant de l'argent non plus pour acquérir d'autres choses mais en reflet de la valeur future de l'entreprise qui les a émis. La SEC le 25 juillet 2017 les a donc qualifiés de securities et leur a appliqué l'intégralité du droit financier, afin que ces investissements et les marchés de capitaux soient protégés.
L'on mesure une nouvelle fois d'une part que la norme de la Régulation réside dans ces buts et que d'autre part son outil principal est dans la qualification des diverses activités qui ne sont "nouvelles" que si le Régulateur veut l'entendre ainsi.
11 septembre 2017
Sur le vif

La nature de la monnaie virtuelle demeure incertaine. En tout cas, l'objet est très attractif, notamment parce que sa nature, présentée comme "nouvelle", implique que son maniement ne soit pas régulé.
Cela permet notamment à des individus ou à des jeunes entreprises d'émettre des "jetons" pour les offrir en échange de fonds (initial coin offerings - ICOs), jetons acquis par des investisseurs, sans être des établissements bancaires, ni recourir à un emprunt, ni émettre des titres de capital.
Les opérateurs demandent à ce que ce comportement soit reconnu dans sa nouveauté et soit reconnu dès lors comme n'étant régi que le contrat et les principes généraux de la loyauté, de l'engagement et de l'information, car ce qui n'est pas interdit est permis tandis que ce qui n'est pas régulé est librement organisé par les parties qui y consentent.
Le Régulateur bancaire de la Chine, vient d'en décider autrement. Il a décidé que les levées de fond par les individus ou les entreprises par le moyen de monnaie virtuelle serait désormais interdit.
La question est de savoir si d'autres Autorités de Régulation pourraient faire pareil.
Lire ci-dessous.
7 septembre 2017
Parutions : 0. Ouvrages
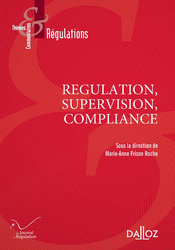
Référence générale : Frison-Roche, M.-A. (dir.), Régulation, Supervision, Compliance, collection "Régulations", Dalloz, 2017, à paraître le 4 octobre 2017.
Consulter le sommaire de l'ouvrage.
Acquérir l'ouvrage en utilisant le bon de commande.
Consulter la Série dans laquelle l'ouvrage est publié aux Éditions Dalloz.
____
Régulation. Supervision. Compliance.
Trois termes jusqu'à peu presque inconnus des systèmes juridiques. Ou à tout le moins considérés comme propres aux systèmes juridiques anglo-américains : Regulation, Supervision, Compliance. Autant d'expressions qui constitueraient comme des chevaux de Troie par lesquels le Droit de Common Law s'emparerait de nos traditions juridiques pour mieux faire plier les entreprises européennes, notamment les banques, et s'approprier les institutions, imposer les méthodes.
Trois mots par lesquels l'invasion est opérée. Par la violence de la répression et des peines de conformité, par la douceur des codes de conduites et de la responsabilité sociétale des entreprises. Par des lois aussi nouvelles qu'étranges comme la loi dite "Sapin 2" ou la loi instaurant un "devoir de vigilance" aux entreprises dont le défaut serait d'avoir réussi à se déployer internationalement.
L'on peut avoir cette conception défensive de la Compliance , en train d'engendrer un "Droit de la Compliance", produit par l'internalisation dans des opérateurs économiques globaux du Droit de la Régulation, lesquels sont alors soumis à une supervision par les régulateurs, alors même qu'ils ne sont pas régulés, la Compliance n'étendant au-delà des secteurs supervisés (banques et compagnies d'assurance).
L'on peut avoir une conception plus accueillante, et donc plus offensive, de la Compliance. Celle-ci peut être le creuset d'une relation de confiance à dimension supra-nationale entre ces opérateurs et les régulateurs, les premiers pouvant contribuer comme les seconds à servir des buts qui les dépassent tous et dont la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent ne sont que des exemples.
Ouvrage collectif , avec les articles de :
- Jean-Bernard Auby,
- Jérôme Bédier,
- Alain Bénichou,
- Jean-Michel Darrois,
- Loraine, Donnedieu de Vabres,
- Isabelle Falque-Pierrotin,
- Marie-Anne Frison-Roche,
- Benoît de Juvigny,
- Bruno Lasserre,
- Arnaud de La Cotardière,
- Jean-Claude Marin,
- Didier Migaud,
- Yves Perrier,
- Jean-Marc Sauvé.
Voir la présentation du cycle de conférences sur lesquelles s'est construit l'ouvrage.
6 septembre 2017
Sur le vif

La régulation du numérique, on s'accorde sur sa nécessité, on en parle beaucoup mais on peine à la faire.
Les enjeux sont multiples : gestion de l'innovation, protection des personnes, traitement des puissances, avenir de l'être humain, le Politique et le Juge étant comme une balle qui ricoche entre ces 4 sujets.
L'on redécouvre alors que les premiers "régulateurs" sont les Gouvernements et que la première modalité du Droit de la Régulation est la fiscalité.
Notamment en matière de numérique et plus encore face au GAFA.
En effet, les 4 entreprises américaines, Google, Apple, Facebook et Amazon, admettent la nécessité de règles mais proposent une autorégulation ou une co-régulation. Celles-ci porteraient non seulement sur leurs propres comportements, mais encore sur ceux des autres, notamment la lutte contre le terrorisme. Quand on est plus fort que les États, il conviendrait de se substituer à leur cœur de métier.
N'entendant sans doute être dépossédés du régalien, l'Europe demande aujourd'hui des "comptes" aux GAFA au sens littéral du terme. En effet, les gouvernements français et allemands vont déposer en septembre une proposition de taxation spécifique aux GAFA, dont le fruit reviendra aux pays où ils tirent leurs revenus.
Les entreprises intéressées répondent que dans le système fiscal réside le droit d'être habile et de s'organiser au mieux, tant qu'on ne tombe pas dans l'abus. Conformément au Droit, le Conseil d’État vient de le rappeler à leur profit.
Le ministre français de l'économie et des finances, Bruno Lemaire, a justifié en août 2017 la réitération de sa volonté, en élevant au niveau européen au nom de la "justice distributive", le Droit étant défini comme ce qui donne à chacun la part qui lui revient. C'est un argument fort, mais dangereux, car s'il est vrai que dans la fonction même de la fiscalité, corrélée aux finances publiques, la fonction redistributive est essentielle, l'optimisation fiscale devient chancelante.
D'une façon plus convaincante et propre à la Régulation, cette mesure d'équité est présentée comme corrélée à la construction du marché numérique européen. Dans la mesure où la fiscalité européenne est encore embryonnaire, son lien avec une telle construction permettrait de voir in vivo la force de l'outil fiscal dans un Droit de la Régulation, plus que jamais distant du Droit de la concurrence.
C'est en cela, et parce que le Marché européen numérique doit être construit au forceps, les GAFA devant en bénéficier mais aussi participer à sa construction, qu'un tel partage de l'investissement se justifie.

5 septembre 2017
Sur le vif

Peut-on faire autre chose ? Davantage ou autre chose ?
Le cas est celui d'une lacune. En effet, les activités sportives sont régulées de la façon la plus classiques, par de la réglementation, des surveillances administratives, des délégations, un contrôle juridictionnel. Des règles s'y appliquent, à la fois juridiques et déontologiques. Les règles les plus fines s'y sont développées, notamment sur la "violence admissible" et celle qui ne l'est pas, par exemple en matière de boxe ou de rugby, à travers la notion de "règles du jeu".
Les jeux vidéos sont à première vue tout autres.
Leur régulation relève d'autres corpus de règles et d'autres régulateurs, par exemple l'Autorité de Régulation des Jeux en Ligne, lorsqu'ils se jouent dans l'espace digital.
Mais le Régulateur des jeux en ligne n'a pas à première vue compétence pour appliquer les "règles du jeu" dans la perspective de ce qu'est le sport et l'intégration particulière de la distinction entre la violence admissible et la violence inadmissible.
A supposer qu'il étende sa compétence à cette dimension-là, le fait que les coups portés ne le soient que "virtuellement" devrait nécessairement modifier le contour et l'application des règles, transformant ce régulateur des jeux en régulateur des sports.
A l'inverse, à supposer que les régulateurs des sports s'en soucient, alors faudrait-il que l'analogie entre le "jeu" et le "sport" soit assez forte pour que l'extension soit s'opérer légitimement.
Or, le critère qui pose problème est justement celui de la violence.
Lire plus ci-dessous.

4 septembre 2017
Sur le vif

Internet a permis de créer un espace de liberté, voire un espace libertaire.
Le flot de propos qui s'y déverse est parfois haineux. Tant pis. Cela serait le prix de la liberté : cela correspond à la fois au projet de ceux qui ont conçu Internet, lieux d'expression et de création, même du pire, et à la culture politique et juridique des États-Unis, système dans lequel la liberté d'expression a valeur constitutionnelle.
Cela permet notamment que prospèrent des idées diffusant une pensée dite "néo-nazie", comme le fait depuis des années le site Stormfront.
Le 25 août 2017, la société privée, Network Solutions qui héberge le site et lui fournit le nom de domaine a mis fin à l'hébergement et supprimé le nom de domaine.
L'hébergeur a également interdit au web master de reconstruire le site ou de le transférer d'une quelconque façon.
Cette affaire donne lieu à une débat sur la montée des extrémistes aux États-Unis d'une part et la limite de la liberté d'expression d'autre part.
Ce qui est ici à relever est le pouvoir d'un hébergeur en la matière.
A première vue, une entreprise privée n'a pas à faire la police, encore moins la morale, et à retirer l'usage d'un nom de domaine, c'est-à-dire à "tuer" un site. Mais il faut sans doute tenir compte du fait que trois ans s'étaient passés et que ce site, base de manifestations prochaines de KKK, prospérait.
Le manager qui prit la décision a trouvé nécessaire de s'en justifier, comme l'aurait fait une Autorité de Régulation, motivant une décision de sanction, et ce alors même qu'il peut se prévaloir des conditions générales d'usage qu'acceptent les entités qui créent et font fonctionner les sites.
Lire la suite ci-dessous :

1 septembre 2017
Analyses Sectorielles

L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) vient de publier son Rapport d'activité 2016, à la Documentation Française.
Le "rapport annuel", exercice de "droit souple", est toujours important en ce que le Régulateur fait passer des messages, exprime sa politique et donne à voir la vision qu'il a de lui-même.
L'Autorité de Régulation met tout d'abord en exergue la régulation "par les données". Il est remarquable que cela vienne avant même l'ouverture à la concurrence, qui est pourtant la fonction donnée par le Législateur à ce Régulateur.
